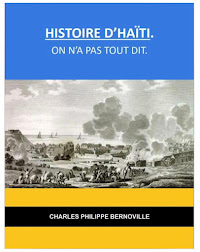Ayisyen m 'ye ||
ÉMISSION 4 : Haïti : Présidence, Sécurité et Élections
Édito de Mathias Pierre :
Le rôle du Conseil Présidentiel de Transition dans la réalisation des élections.
Le Président est le chef de l’État pour les pays à constitution républicaine. Dans l’article 1 de la constitution haïtienne de 1987 amendée il est écrit qu’« Haïti est une république .. démocratique... », et l’article 134 poursuit :, « le chef de l’État est élu aux suffrages universels directes », sauf les exceptions ou dispositions transitoires. On peut lire dans cette même constitution, dans son article 136, que le Président de la République, chef de l’État, veille à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que de la continuité de l’État. En peu de mot, le chef de l’État est le garant de la bonne marche des institutions dans une république démocratique. Peut-on conclure que la faute est au chef de l’État si les institutions démocratiques deviennent dysfonctionnelles ?
Une autre considération significative, Haïti est un pays à faible habitus d’obédience à la loi, et « un faible habitus d’obédience à la loi réduit considérablement les chances de développement démocratique. » 1Le comportement des Haïtiens par rapport à la loi se résume dans cette vieil adage, « konstitisyon se papye, bayonet se fè. » Cela traduit le refus du respect de la constitution et de la loi. Est-ce parce que les constitutions ne sont pas adaptées aux traditions, aux coutumes et aux mœurs haïtiennes, où parce qu’elles sont calquées sur des modèles occidentaux non adaptés aux réalités du pays ? Est-ce par absence d’une université génératrice d’idées nouvelles ? Est-ce parce que le Capital humain est préparé dans les universités occidentales ? Le pays a déjà connu 24 constitutions et un amendement durant ses 220 ans d’existence. Les élites évoquent toujours la constitution dans leurs discours mais le pays est dirigé pendant une bonne partie de son existence par les dispositions transitoires des constitutions. Quand ce ne sont pas les lois particulières qui régissent le fonctionnement des institutions, ce sont les dispositions transitoires des constitutions qui deviennent des lois permanentes. On peut déduire que c’est pour satisfaire leurs désirs personnels que certains de nos chefs d’État puissants ont promulgué leurs propres constitutions.
Le manque de volonté des chefs de l’État à faciliter l’organisation des élections, une fois assermenté, et ceci depuis les premières élections d’après l’adoption de la constitution de 1987, est un comportement qui a contribué à l’affaiblissement de la démocratie. Depuis la constitution de 1987, puis amendée en 2012, Haïti ne s’est doté ni d’ institution électorale permanente ni de loi électorale. Après chaque élection suit des moments de crises et de violences, avec des conséquences multiples sur la stabilité politique. Avant chaque nouvelle élection, les dispositions transitoires de la constitution sont utilisées pour la mise en place d’un conseil électoral provisoire et d’un décret électoral. C’est un artifice qui contribue à la délégitimation des élections au point que les potentiels électeurs ne sont plus intéressés à aller voter. Pour preuve le taux de participation aux dernières élections est passé de 45% en 2006 à 20% en 2015-2016.
La compétition politique dans le respect des prescrits de la constitution est essentiel à la démocratie. Son institutionnalisation est de la responsabilité du chef de l’État. Tous les présidents élus en font obstacles par le report des élections législatives constitutionnelles de mi termes jusqu’à la caducité du parlement. Sans loi électorale ni Conseil Électoral Permanent, à la fin de leurs mandats, les présidents utilisent les dispositions transitoires de la constitution qui prévoient un conseil électoral provisoire. Le Président Michel Martelly, en dépit du fait qu’il ait comme tous les autres constaté la caducité du parlement, fit deux tentatives pour mettre un conseil électoral permanent, mais il a été empêché par le parlement. Les deux pouvoirs établis, tant exécutif que législatif font obstacles à l’institutionnalisation du système électoral. Les pouvoirs exécutifs depuis 1990, même avec une majorité d’élus, développent une crainte de l’opposition parlementaire. Ils n’attendent que la fin des mandats des parlementaires, qui généralement arrive toujours avant ceux des présidents, pour constater leur caducité sans organiser d’élections, dans l’unique but de diriger seul par décret.
Dans un mandat, 4 ans pour le parlement et 5 ans pour la présidence, le but devrait être d’harmoniser pour une bonne gestion de la barque nationale, consolider la démocratie, stabiliser pour la croissance économique. Les affrontements autodestructeurs inconscients des deux branches du pouvoir, aux dépens de la collaboration ne fait que les ruiner et à la fin les deux sont perdants. Des présidents, peu arrivèrent à se perpétuer en faisant élire leurs dauphins, des parlementaires les plus zélés peinent souvent à se faire réélire. Une fois que le bras de fer exécutif et législatif débute et s’accentue, l’opposition politique au pouvoir en place prend le relai, les mouvements de rues s’intensifient, la violence augmente, et les appels à la démission du président en faveur d’un pouvoir transitionnel deviennent plus convaincants. Et là, l’instabilité politique franchie la ligne rouge, il devient difficile de faire marche arrière. Un pouvoir de transition finit par prendre les rênes à la fin du mandat du président élu, avec des conséquences désastreuses pour le pays, et un affaiblissement de la démocratie causé par la déstabilisation du système politique.
Le rôle de la Présidence est de s’assurer du bon fonctionnement des institutions, dans le cas particulier de l’institutionnalisation du système électoral. Il s’agit de faciliter la mise en place d’un cadre légal, de mettre en place l’institution électorale permanente, en plus d’allouer les ressources financières nécessaires au financement de l’organisation des élections. Tous les pouvoirs ont raté ce moment critique de renforcement des institutions démocratiques, et le pays s’y retrouve avec un pouvoir transitionnel. Le tout dernier est le Président élu Jovenel Moise, en repoussant l’organisation les élections sénatoriales de 2019 et en constatant la caducité de la chambre des députés en 2020 sans organiser les élections législatives, s’est retrouvé seul à diriger mais son assassinat avant la fin de son mandat, créa un vide inédit. De fait, le pays se retrouve dans une transition gérée sans provision constitutionnelle avec absence de légitimité des dirigeants dans une incertitude sans précédent.
Haïti se retrouve soudainement dans un régime transitionnel sans un destin réel, et sans une volonté d’organiser des élections pour le retour à l’ordre démocratique, ce qui hypothèque l’avenir de la démocratie. Un autre facteur vient compliquer les donnes, le rétablissement de la sécurité, une équation à résoudre dont toutes les hypothèses ne sont pas posées encore pour trouver les bonnes solutions. Entretemps le cauchemar pour la population perdure. Le cadre légal pour résoudre l’insécurité existe, mais la volonté pour la mise en place d’une équipe capable de définir la stratégie ne se manifeste pas encore. Tous ces éléments doivent être considérés pour comprendre les défis de la transition 2021-2026. D’un côté, les gangs armés et la violence en son point culminant, une présidence issue d’un accord politique, un mandat avec deux chantiers presqu’impossibles à satisfaire, des partis politiques avec des ambitions illimitées, l’improvisation d’une présidence et le désir d’accumulation du maximum de ressources financières pour les prochaines élections par certains quand il y en aura. Ainsi la démocratie est en péril avec le risque d’une transition qui n’en finit pas. D’une transition après chaque élection, Haïti retourne dans les années 1986-1990, des transitions qui se succèdent, mais dans le contexte géopolitique actuel, le cycle d’instabilité risque d’être plus long. Face à cela, il reste la question de comment normaliser le processus de transfert de pouvoir institutionnel sans la personnalisation ?