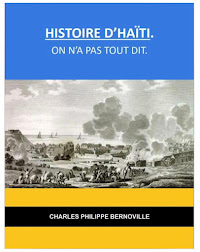Ayisyen m 'ye ||
Émission 11 : Le parlement et les élections en Haïti
L’Édito de Mathias Pierre
Monsieur le député, quel est son rôle dans la démocratie haïtienne ?
Dans une émission sur le contrat social haïtien, nous avions fait référence à l’œuvre de Jean Jacques Rousseau, « Du Contrat Social » qui souligne l’importance de conclure un pacte communautaire pour limiter les ambitions individuelles au service du bien commun. Ce pacte social est normalement défini dans la constitution. Haïti dans sa constitution de 1987 est définie comme étant une république démocratique, mais elle peine à trouver la cohésion entre ses élites et ses masses dans une constitution adaptée à ses coutumes et ses mœurs pour un régime politique qui serait clairement accepté.
Dans « De L’esprit des Lois » publié en 1748, Montesquieu définit les lois comme « les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses… », en ce sens, les lois mères d’Haïti, ses constitutions, ont-elles été dérivées de la nature des choses de la société ? Plus loin, après une analyse profonde des différents régimes politiques, Montesquieu conçût les bases de la démocratie moderne par l’élaboration du principe de la « séparation des pouvoirs ». Il ne décrit pas « l’état de nature » à la manière de Hobbes comme un état de guerre où chaque homme est un loup pour l’autre, mais plutôt un processus pour lequel « l’homme rentre en société pour échapper à l’état de guerre qui caractérise l’état de nature. » D’où la nécessité d’avoir des lois mais que les pouvoirs ne soient pas concentrés entre les mains d’un seul homme.
Le principe de la « séparation des pouvoirs » est à la base d’une république, plus loin démocratique, toujours dans l’esprit de la déconcentration des pouvoirs. Et là, le théoricien démontre l’intérêt des trois pouvoirs qui sont le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ainsi, Haïti étant une république démocratique se plie théoriquement à ce principe de la « séparation des pouvoirs ».
Avant d’aller plus loin, différentes sociétés selon leur histoire et leur parcour, font le choix ou se sont construit une certaine forme de république. L’Angleterre garde sa monarchie et construisit une démocratie parlementaire qui est connue sur le système anglais. La France abandonna la monarchie, après des périodes d’incertitudes, cinq républiques, pour adopter une république démocratique présidentielle, à l’instar des Américains mais qui fondèrent une république démocratique présidentielle mais d’une certaine unicité.
Haïti depuis la constitution de 1987 fait choix d’une république démocratique présidentielle avec un exécutif faible et un législatif. La constitution définit le rôle du pouvoir législatif, constitué de deux branches, une chambre des députés et un sénat, dans son article 111, elle stipule que « Le pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public. » Les deux chambres se réunissent en assemblée nationale pour exercer certaines prérogatives constitutionnelles. Depuis quelque temps le parlement haïtien passe à côté de ses responsabilités pour devenir dysfonctionnel, selon certains, même inutiles.
L’une des causes du dysfonctionnement des parlements haïtiens, est l’absence de l’institutionnalisation des partis politiques. Le parlementaire, dans la plupart des cas, est un individu à la recherche d’opportunité économique ou d’influence qui cherche le support d’un parti politique pour se porter candidat, et une fois élu, il ne travaille que dans ses intérêts personnels au détriment de la communauté représentée. Dans certain cas, le député haïtien se transforme en un agent de développement improvisé fonctionnant sans cadre légal pour devenir un élément de la machine de la corruption. Le député utilise le développement de sa communauté comme prétexte pour influencer le pouvoir exécutif afin d’avoir des faveurs dans le budget national sous le couvert de développement communautaire. Dans le modèle actuel, le député et son utilisation de sa position, est un mélange qui donne parfois dégoût.
Depuis les toutes premières élections dites démocratiques de 1990, où la coalition FNCD remporta la présidence et la majorité parlementaire, il fallait que quatre mois pour que s’éclate le conflit législatif face à l’exécutif. Ces élections étaient aussi parmi les rares où une coalition remporta la majorité parlementaire, à l’exception de 2000 où le parti politique Lavalas eut la majorité qui permit au Président de diriger sans conflit avec le parlement. Dans tous les autres cas, les conflits sont ardus et lassants, les parlementaires devinrent des forces de nuisance et constituèrent une forme de blocage aux présidents, qui eux à leur tour cherchèrent à sortir par le constat de la caducité du parlement. Ainsi comme les mandats des parlementaires arrivent toujours à termes avant ceux des présidents, ces derniers n’attendent que ce moment pour diriger seuls par décret, tout en évitant d’organiser les élections intermédiaires pour le renouvellement du parlement. Ainsi après chaque élection, le pays se retrouve quatre plus tard avec un parlement décapité parce que la cohabitation des pouvoirs devient toxique. Une toxicité néfaste à la démocratie haïtienne.
Le conflit législatif face à l’exécutif finit toujours par empêcher l’organisation des élections générales. Le législatif bloque, dans la majeure partie, la formation du conseil électoral permanant et le vote de la loi électorale, et l’exécutif à son tour bloque l’organisation d’élection mi-terme pour le renouvellement du parlement. Ainsi après chaque mandat, à quelques exceptions rares, Haïti tombe dans un tourbillon de pouvoir transitoire. La transition qui en découle à chaque fois se fait sans parlement, d’où la disparation du pouvoir législatif, l’organe de contrôle, dans les transitions à l’exception de celle de 2016.
Le défi de la démocratie haïtienne est de trouver la formule pour la cohabitation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif pour la bonne marche de la barque nationale. Certains pensent qu’une réforme constitutionnelle pour une réforme du pouvoir législatif afin de confiner les parlementaires dans leurs rôles pourrait résoudre le problème. Une telle réforme pourrait aussi rétablir le pouvoir réel de gouverner à la présidence, tout en éliminant le poste de premier ministre sous contrôle du parlement. Le parlement serait circonscrit dans sa mission de faire des lois et de contrôler l’action gouvernementale, sans intervenir directement dans le gouvernent. C’est une hypothèse, car en absence de partis politiques institutionnalisés et une constitution qui s’adapte aux coutumes et aux mœurs des Haïtiens, il sera difficile d’accomplir ce rêve de cohabitation, un pilier indispensable à la stabilité politique.