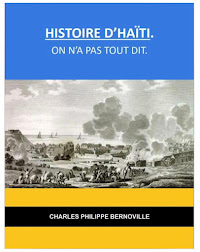Ayisyen m 'ye ||
ÉMISSION 5 : Défis et Réformes du Système Électoral Haïtien
Édito de Mathias Pierre :
Haïti: L’histoire des élections, défi et réformes du système électoral.
Dans son sens classique, une élection est définie comme « la désignation, par le vote d'électeurs, de représentants chargés de les représenter ou d'occuper une fonction en leur nom. » Dans les démocraties modernes, les élections sont le mécanisme par lequel les citoyens, par le biais de la règle de la majorité, choisissent des représentants investis de la légitimité d'exercer le pouvoir. Le processus électoral sert ainsi de pont pour transférer cette légitimité du peuple à l’État –à travers des élus–, qui a pour mission fondamentale d'assurer la sécurité, de fournir des services, et de bâtir des institutions au service de la population.
Pour garantir l’intégrité de ce processus, les cadres électoraux se structurent autour de trois grandes phases :
1. Phase préélectorale : Cette phase comprend le recensement, le découpage électoral, le dépôt des candidatures, et la campagne électorale.
2. Phase électorale : Elle couvre le déroulement des opérations de vote ainsi que le dépouillement des bulletins dans chaque bureau de vote, jusqu’aux résultats préliminaires ;
3. Phase post-électorale : Cette dernière phase implique la centralisation des dépouillements, les contentieux, la validation des données collectées, et la proclamation des résultats. Ce cadre est appliqué dans les grandes lignes prescrites par la constitution haïtienne.
Les élections en Haïti
Les premières élections en Haïti remontent à 1806, à la suite de l’assassinat de Dessalines. Ces élections furent entachées d'irrégularités ; chaque paroisse de la jeune nation désigna un représentant à l’Assemblée nationale, soit 56 représentants pour 56 paroisses. Cependant, des retards planifiés dans le département du Sud permirent à chaque paroisse de cette région d’élire deux représentants, augmentant le nombre de membres de l’Assemblée à 74 au lieu de 56. Cette manipulation changea la majorité en faveur des factions de l’Ouest et du Sud, provoquant la division entre le Nord, dirigé par Christophe, et l’alliance Ouest-Sud, dirigée par Pétion. Ce sabotage électoral déclencha douze années de guerre fratricide. La constitution de 1806, issue de cette période troublée, limitait le mandat présidentiel à quatre ans, mais l’amendement de 1816 instaura la présidence à vie jusqu’au renversement de Boyer en 1843.
Les élections de 1946 comptent parmi les plus marquantes, avec l’établissement d’un pouvoir législatif bicaméral composé de députés et de sénateurs. L’Assemblée nationale élit le président Dumarsais Estimé au suffrage universel indirect avec 31 voix sur 58 pour un mandat de six ans (1946-1952). En 1949, Estimé tenta de prolonger son mandat par un amendement constitutionnel, une démarche interdite par la constitution de 1946, ce qui mena à sa destitution par un coup d’État militaire en 1950.
Après une période de turbulences entre 1956 et 1957, marquée par plus de quatre présidents de transition, les élections de septembre 1957 virent l’élection de François Duvalier au suffrage universel direct pour un mandat de six ans. Duvalier réussit là où d’autres avaient échoué, en obtenant une prolongation de son mandat : par amendement constitutionnel et une nouvelle élection en 1963, il fut nommé président à vie avec le droit de désigner son successeur, jusqu’au départ de son fils en 1986.
Le départ des Duvalier en 1986 mena à une nouvelle assemblée constituante et à l’adoption de la constitution de 1987, qui introduisit le suffrage universel direct à tous les niveaux : présidentiel, législatif et territorial. Ce fut le début d'une nouvelle ère démocratique avec une série d'élections : 1987 (interrompue dans la violence), 1988 (conduisant à un exécutif et un parlement renversé par un coup d'État quatre mois plus tard), et 1990. En 1994, le président élu Jean Bertrand Aristide, chassé par un coup d’État, est rétabli dans ses fonctions pour terminer son mandat. S’ensuivit une série d’élections en 1995, 2000, 2006 et 2011 – toutes contestées pour diverses raisons, à l'exception de celle de 1995, provoquant des bouleversements politiques. L’amendement de 2011 à la constitution de 1987, qui permit les élections de 2015-2016, fut la goutte de trop : il précipita Haïti dans un chaos généralisé. Depuis, le système est dépassé, et l’absence d’élections depuis huit ans n’a fait qu’accroître le désordre.
Depuis l’assassinat du président SEM Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, Haïti traverse une transition sans précédent, sans président de 2021 à avril 2024, avec neuf présidents intérimaires en six mois. L’insécurité règne dans le département de l’Ouest et une partie de l’Artibonite, tandis que le pays attend des réformes constitutionnelles et des élections.
Alors que les élections sont de plus en plus décriées et que le taux de participation chute en raison du désintérêt populaire, le défi haïtien consiste à restaurer l’ordre démocratique avec des dirigeants légitimes pour assurer un retour à la stabilité politique.
Comment une réforme constitutionnelle pourrait-elle aboutir à une véritable constitution, un véritable instrument de stabilité politique, rompant enfin avec la logique du « konstitisyon se papye, bayonèt se fè » ? Comment organiser des élections permettant d’élire des dirigeants conscients de leur mission collective de maintenir la paix et de favoriser le développement économique ?
L’histoire révèle certains maux chroniques dans les pratiques politiques haïtiennes:
● L'attrait de la présidence à vie et le mépris récurrent des lois et de la constitution ;
● La tendance à considérer les élections comme un passage vers le pouvoir, suivi d'efforts pour fermer cette voie à d’autres au profit de soi ou de son dauphin ;
● Une stratégie persistante de conservation du pouvoir à vie, malgré l'échec de tous ceux qui l'ont tenté, à l'exception de François Duvalier.
La véritable crise électorale en Haïti, est-ce une question d’intégrité des élections ou le symptôme d’une profonde réticence à respecter l’obéissance aux lois ?