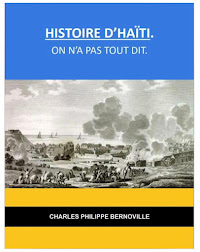Ayisyen m 'ye ||
ÉMISSION 6 : Les femmes dans la vie politique
Édito de Mathias Pierre :
Le défi de la participation des femmes dans la vie politique en Haïti.
En Haïti, les femmes étaient considérées mineures jusqu’en 1982. Toutefois, on doit remonter à 1934, à la Ligue féministe d’action sociale, dédiée à la promotion de l’émancipation des femmes et leur égalité, la toute première association sous la direction de Yvonne Hakim Rimpel, pour le début d’un mouvement de renversement du statuquo. De cette initiative naquit en 1935, un premier journal du nom de La Voix des Femmes, un médium pour donner une voix aux femmes et pour la défense de leurs intérêts communs. Il fallait attendre 1986 pour une expansion du mouvement d’émancipation des femmes dans le pays. Un certain nombre de figures féminines se sont élevé pour marquer leur temps par leurs impacts sur le mouvement féministe. Le mouvement pour l’intégration des femmes a pris une tournure importante avec la constitution du 29 mars 1987, puis celle amendée, dans son article 17-1 qui stipule :
« Le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femme est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics. » Ce principe de quota 30% sera sur les 38 dernières années le cheval de bataille des femmes dans leur lutte pour l’intégration dans la vie politique, bien qu’on soit en droit de se poser des questions sur les avancées réelles, quand on évalue la question des droits des femmes sur les dix dernières années.
Les femmes en Haïti font face à un ensemble de défis majeurs dans leur participation effective à la vie politique. D’un côté, elles sont marginalisées à l’intérieur des structures politiques, de l’autre elles sont bloquées par les traitements subis dans la hiérarchie surtout à l’accès au leadership dirigeant des partis politiques. Les femmes dans la politique sont victimes des conséquences d’un ensemble de tares du système patriarcal comme les préjugés sexistes et psychologiques. Par exemple, un mari peut facilement empêcher sa femme, sous pression de violences verbales, parfois physiques, de participer aux activités politiques. Est-ce pour cela qu’elles se regroupent en majeur partie dans les organisations de femmes, et depuis quelque temps, ces organisations sont dénombrées par centaines pour des raisons diverses, surtout par intérêts personnels?
Les femmes sont absentes dans les partis politiques en Haïti, surtout au niveau de leurs directoires parce qu’elles sont considérées naturellement inégales aux hommes. Selon Laenec Hurbon, « la société haïtienne porte la marque d’une société qui fonctionne sur l’infériorisation des femmes et la domination masculine, en sorte que la démocratie est imaginée dans l’exclusion systématique des femmes dans la vie politique, parce qu’elle relègue les femmes dans la condition de citoyennes de seconde zone... » C’est une société patriarcale qui refuse systématiquement le droit aux femmes dans les hautes sphères de la politique, d’abord dans les partis politiques. Le congrès national dans un parti politique est l’expression même de la démocratie à l’intérieur du parti, certains dirigeants refusent le principe du congrès, une façon de bloquer l’accession des femmes dans la hiérarchie, une particularité non exclusive aux hommes.
La situation devient encore plus compliquée pour les femmes dans les élections en Haïti. Malgré le quota exigé par la constitution, le fait aux partis politiques d’ignorer le principe du quota de 30%, en plus fu fait de la faible participation des femmes dans les activités politiques, lors des élections, le résultat est désastreux lorsqu’on regarde le nombre d’élues de sexe féminin. Aux dernières élections de 2015-2016, il y a eu 3 députés femmes élues sur 119 et une sénatrice sur 30. Le décret électoral de 2015 a exigé qu’aux collectivités dont la composition est des cartels de 3 membres, qu’il y ait une femme obligatoirement, ce à faciliter l’élection d’au moins une femme dans chaque cartel pour atteindre le quota des 30% exigé par la constitution. L’une des causes principales de la faible participation des femmes aux élections est la violence et surtout leur incapacité à mobiliser les fonds pour la campagne. Hurbon suggère l’éducation et l’assistance juridique comme instrument pour pousser les partis politiques à supporter les femmes et surtout dans les élections.
L’application du quota reste un vœu et depuis 1987, à chaque gouvernement il y a ce combat des organisations de femmes pour obtenir d’abord la gestion du ministère à la Condition féminine et ensuite les 30% de femmes dans les gouvernements. Ceci est presqu’un acquis, sauf que très souvent les femmes qui sont sélectionnées dans la majeure partie des cas pour ces postes, ne travaillent pas nécessairement dans l’intérêt du mouvement féminin afin de faire avancer l’agenda de l’émancipation et de l’intégration des femmes. Dans la plupart du temps, on selecte une femme pour avoir une représentation féminine, mais pas une femme idéologiquement orientée dans la ligne à faire progresser le mouvement. Dans cette perspective, on a atteint les limites de l’application du quota 30% prôné par la constitution de 1987, un quota respecté dans l’assignation des postes nominatifs avec les contraintes sus mentionnées dans les postes électifs, toutefois sans faire avancer la cause des femmes.
Pour atteindre le quota dans les postes électifs, certains pays comme le Rwanda, que j’ai eu l’opportunité de visiter pour regarder l’application du quota 30% dans les élections, il y a 70% de postes électifs où les électeurs sont libres de choisir, par suffrages universels directs, des hommes ou des femmes, et dans les 30% restant des membres du parlement, ce sont aux organisations de femmes, par suffrages universels indirects, qu’incombent la tâche de désigner les femmes à être membres du parlement. Le Rwanda arrive, dans ces conditions avec un parlement de plus de 50% de femmes élues. Le cas du Mexique est différent, la parité 50/50 est prévue dans la constitution, ainsi dans les dernières élections une femme vient d’être élue Présidente de la République.
Le projet de la réforme constitutionnelle prône le quota de 35% avec les sièges réservés aux femmes pour remédier aux contraintes de l’application des 30% de la constitution de 1987. En principe, les solutions aux discriminations socio-culturelles passent nécessairement par des décisions consensuelles. Les inégalités négatives sont souvent corrigées par des inégalités positives, ce principe étant partout reconnu. En Haïti, on prévoit d’ajouter aux sièges existant à la chambre basse, 35% de sièges uniquement réservés aux femmes-candidats des partis politiques. Les sièges seront créés dans les mégapoles, parallèlement aux circonscriptions existantes. Par exemple, dans les circonscriptions peuplées - comme Pétion-Ville, Delmas, Carrefour, Cap-Haitien - les électeurs auront à voter pour 2 députés dont une femme obligatoirement pour un des postes.
Il faut l’institutionnalisation des partis politiques, mais aussi faire un amendement de la loi sur le fonctionnement des partis politiques pour faciliter le respect du quota à tous les postes électifs et exiger plus d’espaces aux femmes à travers l’éducation, et l’assistance juridique. Les partis politiques, au même titre que l’État, doivent être forcés d’appliquer la constitution et de respecter le principe du quota à tous les niveaux et même dans leurs directoires. Ce qui faciliterait l’intégration réelle des femmes la vie politique haïtienne.
Dans une telle démarche, le pays ne fera que gagner car de manière générale, il y a une certaine domination en nombre de la femme dans différents secteurs de la vie nationale. Ces dernières sont majoritaires dans l’enseignement, dans leurs apports à l’économie, plus précisément les micro-entreprises commerciales ou l’industrie de la sous-traitance. Les femmes sont le pilier des familles dans cette société matrifocale. Les femmes sont majoritaires en Haïti avec plus de 52%. Elles peuvent avoir un impact majeur sur la politique. La seule femme présidente provisoire d’Haïti en 1990, Ertha Pascal Trouillot, a pu faciliter l’organisation des premières élections démocratiques dans le pays. Il est certain qu’une plus forte participation des femmes dans la vie politique permettra d’aboutir à une certaine stabilité politique, donc un impact certain sur la croissance économique.